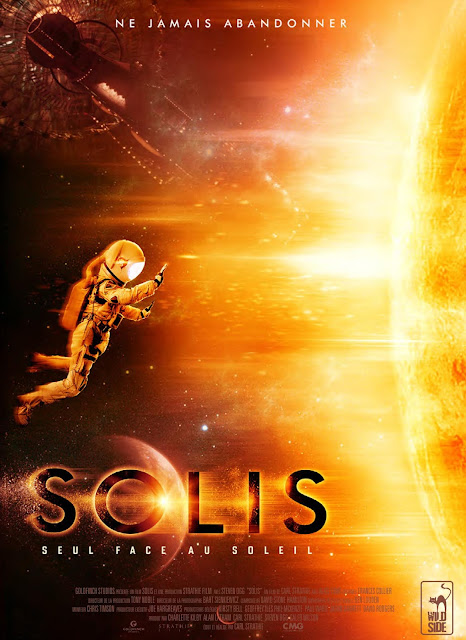Le funeste destin de la
série The First
m'évoque une chanson. L'Aquoiboniste
de
Jane Birkin. En fait, tout dans cette série américaine de
science-fiction créée par Beau Willimon et diffusée pour la
première fois sur la plateforme HULU
renvoie
ne serait-ce qu'au titre de cette sympathique mélodie écrite et
composée par Serge Gainsbourg. Cet aquoibon dont se parent souvent
les producteurs lorsqu'un programme cinématographique ou télévisuel
ne remplit ni le cahier des charges, ni les poches de leurs
créanciers ! Aquoibon donner aux spectateurs les premières
miettes d'un concept fort encourageant, si peu original soit-il (la
conquête spatiale vers la planète Mars étant devenue l’apanage
de nombreuses séries et longs-métrages), pour ensuite leur retirer
la fourchette, le couteau et l'assiette du ''délicieux'' plat qu'ils
avaient devant leurs yeux. Si l'on se réfère à son seul titre, The
First
n'a d'emblée rien de très prometteur. Le premier. Okay, mais de
quoi ? Par contre, si l'on suit le synopsis et la richesse que
cache l'idée d'une colonisation de la Planète Rouge, là c'est
autre chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, la série démarre plutôt
bien puisque d'emblée, nous sommes en 2033 et l'on assiste au
décollage d'une fusée à destination de Mars... laquelle explose en
plein vol, faisant ainsi d'une partie des spectateurs venus assister
à l'événement, des familles endeuillées ! Dès lors, un
procès va opposer ces dernières, les dirigeants de la société
privée VISTA
qui collabore avec la NASA
ainsi que les membres du Congrès s'agissant de la pérennité du
projet. L'on apprend également qu'il faudra patienter presque deux
ans et la prochaine fenêtre de tir pour envoyer la prochaine fusée
et son nouvel équipage à destination de Mars. Deux ans ! Et
autant de raisons proprement absurdes pour les scénaristes de se
concentrer presque exclusivement sur la caractérisation des
personnages. Et c'est bien là que le bât blesse. Faisant ainsi des
créateurs, des réalisateurs (Deniz Gamze Ergüven, Agnieszka
Holland, Ariel Kleiman et Daniel Sackheim) et des scénaristes (Beau
Willimon, AJ Marechal, Francesca Sloane, Francine Volpe, Julian
Breece, Carla Ching et Christal Henry) les complices d'une œuvre
presque mensongère.
Du
moins en ce qui concerne la forme sous laquelle va se présenter
cette première saison qui selon les dires de celles et ceux qui
l'ont découverte dans son intégralité (huit épisodes en tout) se
passe exclusivement sur le sol terrestre. On n'en voudra évidemment
pas aux auteurs de cette série mettant en scène l'acteur Sean Penn
dans le rôle de l'astronaute Tom Hagerty et l'actrice Natascha
McElhone dans celui de l'une des responsables du projet, Laz Ingram,
d'avoir voulu accorder une très grande importance à la
caractérisation des principaux personnages, mais de là à les
garder les pieds sur Terre tout au long de la saison alors que les
spectateurs ne rêvaient que de voir un groupe d'astronautes prendre
son envol vers la Planète Rouge, on peut comprendre que ceux-ci se
soient rapidement désolidarisés du concept, causant ainsi
d'irrémédiables dommages sur la continuité de la série !
Aquoibon, donc, se farcir les affres des uns et des autres même si
au moins un épisode s'avère émotionnellement très bien écrit (le
second, intitulé Ce
qui est nécessaire) ?
Entre ce qu'attendaient les téléspectateurs et l'approche des
scénaristes, forcément, cela ne pouvait pas matcher. D'autant plus
qu'en terme d'émotion, justement, l'on passe d'un épisode très
réussi à un autre dont le contenu est d'une faiblesse scénaristique
crasse (le troisième, Cycles).
Si l'on conjugue ainsi le propos mensonger qui voudrait que la série
transporte ses protagonistes à plus de soixante millions de
kilomètres de notre planète à des sous-intrigues dont la qualité
d'écriture joue au yo-yo et varie donc selon leurs auteurs et leur
inspiration, rien d'étonnant à ce que The First
n'ait pas trouvé son public. Réduire ne serait-ce que de moitié
l'exposition sur Terre pour ensuite lancer les personnages dans cette
grande aventure spatiale qu'est la conquête de Mars aurait sans
doute renversé la vapeur et nourrit l'espoir d'une seconde saison
viable et riche en promesses...


.png)